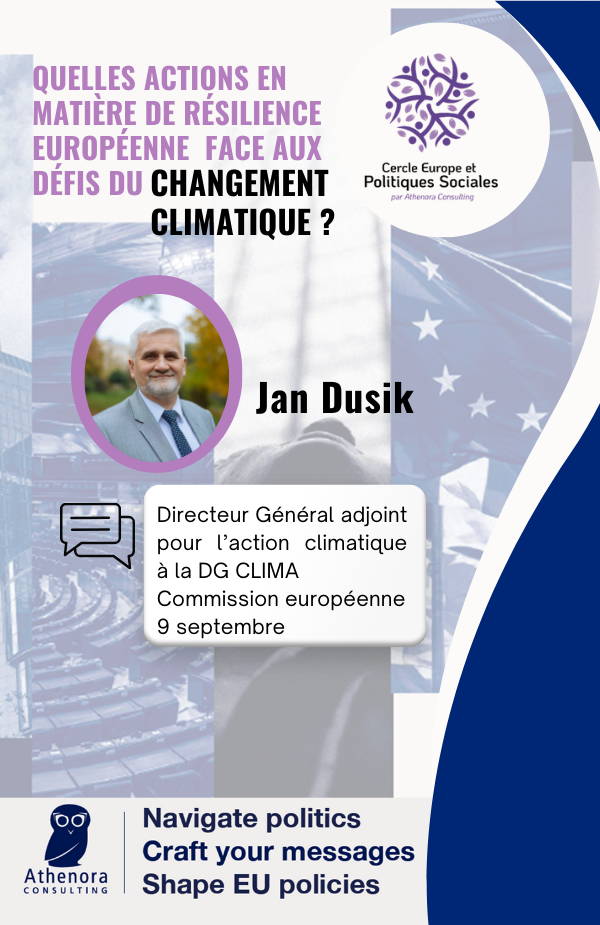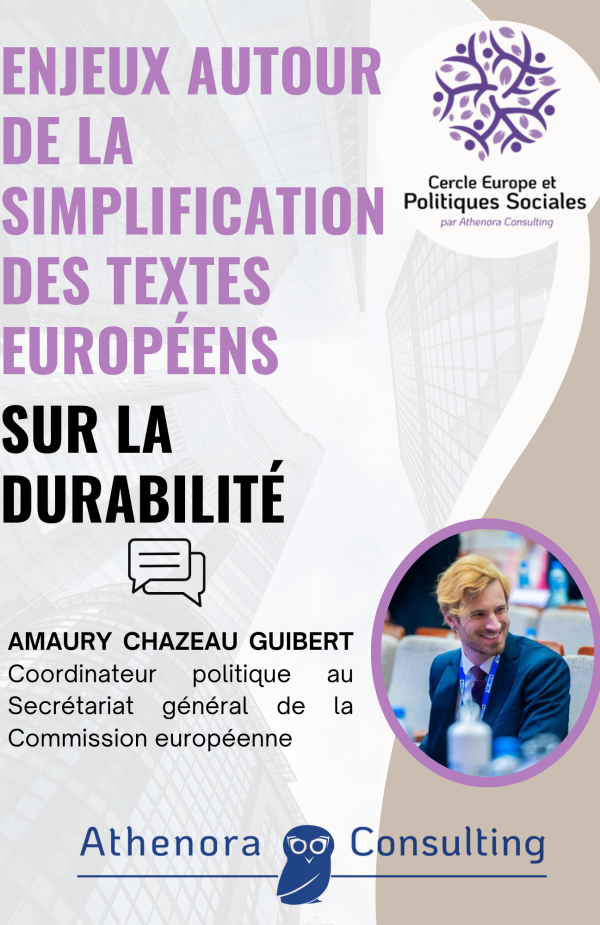News & Events
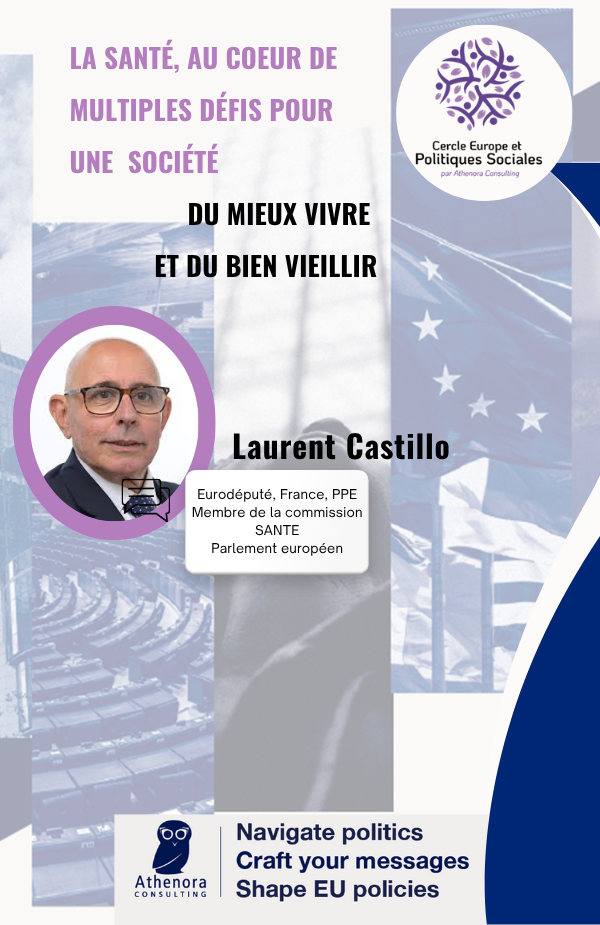
La seconde mandature d’Ursula von der Leyen met l’accent sur la compétitivité, la défense et les omnibus de simplification, avec peu d’annonces sur les enjeux de santé. La nomination du commissaire hongrois Olivér Várhelyi, chargé d’un portefeuille santé réduit, illustre cette mise en retrait et questionne sur l’importance accordée par l’UE aux politiques de santé.
Pourtant, dans un contexte marqué par le vieillissement démographique, les tensions géopolitiques et le changement climatique, la santé demeure une préoccupation centrale pour les citoyens.
L’Union européenne dispose toutefois de marges de manœuvre limitées dans ce domaine : la santé relève d’une compétence partagée, où le principe de subsidiarité donne la primauté aux États membres, notamment pour les systèmes de protection sociale. Il est donc logique que les questions d’organisation des systèmes de santé ou des remboursements.
L’Union européenne a néanmoins des compétences lorsqu’il s’agit d’organisation du secteur de la santé, des réflexions sur la libre prestation des professionnels de santé à l’achat commun de vaccin, de la réglementation sur les médicaments à celle des dispositifs médicaux. Sur ce sujet, Laurent Castillo s’est mobilisé pour appeler la Commission européenne à revoir les règles afin de ne pas étouffer les entreprises européennes, confrontées à des réglementations très strictes et onéreuses. En quatre ans, la France a perdu 300 PME sur les 1500 existants avant la crise Covid. Les conséquences impactent directement les secteurs de la recherche et de l’innovation ainsi que les patients.
La santé est également concernée par les effets du réchauffement climatique et par le recul des priorités environnementales au sein de la Commission. Les émissions de gaz à effet de serre ont un impact direct sur la santé des citoyens, mais le sujet reste clivant, à la fois entre la Commission et le Parlement, et au sein même des opinions publiques.
Le rapport de prospective stratégique 2025 de la Commission européenne, Resilience 2.0» (lien) souligne l’impact du vieillissement de la population sur l’économie et les systèmes de santé européens. Par ailleurs, la crise Covid a permis à l’UE de prendre conscience de son absence d’autonomie stratégique dans le secteur de la recherche comme celui des vaccins. La crise sanitaire a également permis d’identifier le déficit majeur en termes de médicaments et d’industries et la dépendance inquiétante de l’UE vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. La situation de bras de fer avec les États-Unis notamment sur la question des médicaments montrent que l’UE ne peut plus être naïve et doit assurer les conditions de son indépendance en matière de santé.
Deux axes sur lesquels l’action de l’UE pourrait être renforcée sont la prévention et la recherche.
La prévention est essentielle pour réduire les dépenses de santé, accroître l’espérance de vie en bonne santé et améliorer le bien-être des citoyens. Chaque année supplémentaire d’espérance de vie en bonne santé représenterait environ 10 milliards d’euros d’économies. Or, en France, l’espérance de vie en bonne santé (63-64 ans) reste inférieure à celle de pays nordiques qui investissent massivement dans la prévention et l’éducation à la santé. Actuellement, moins de 3 % des dépenses du budget de santé y sont consacrées, notamment au dépistage. Le principal frein au développement de la prévention reste l’absence d’indicateurs de résultats rapides, qui limite l’adhésion des décideurs politiques et la bonne compréhension des citoyens. Il faut passer d’une société du soin à une société de la prévention.
L’éducation et la formation des citoyens aux enjeux de santé doivent aussi être renforcées pour leur permettre de devenir de véritables acteurs et de saisir les enjeux majeurs. Mais elles ne suffisent pas : l’UE a également un rôle à jouer dans la régulation, par exemple via l’encadrement des réseaux sociaux et des influenceurs dans le cadre du Digital Fairness Act par exemple, afin de lutter contre la désinformation et de restaurer la confiance dans la parole scientifique. Une consultation est actuellement en cours sur le site de la Commission et ouverte jusqu’au 24 octobre : Digital Fairness Act.
L’élargissement des compétences du Health Emergency Preparadness and Response (HERA) pourrait aussi constituer une piste intéressante. Le rôle de l’UE dans la gestion des épidémies sanitaires est logique, l’UE doit avoir la capacité de se mobiliser face aux crises.
L’autre axe important concerne la recherche où des économies d’échelle sont évidentes notamment sur la question des maladies rares ou du cancer. Le plan d’action de lutte contre le cancer montre l’impact d’une action au niveau de l’UE. Le financement de la santé et de la recherche dans le prochain cadre financier pluriannuel doit être une priorité, mais elle n’est pas la seule, dans un contexte de réduction des budgets. De plus le volet dédié à la santé n’est pas vraiment visible dans la nouvelle architecture.
L’essor des nouvelles technologies, et notamment de l’intelligence artificielle, transforme les métiers de la santé et du soin et nécessite au secteur de s’adapter et d’évoluer rapidement. L’accès aux données de santé constitue un autre enjeu majeur : il permettrait une meilleure mobilisation des ressources humaines et médicales, ainsi qu’une délégation plus efficace des tâches. Ces évolutions invitent à repenser en profondeur les systèmes de santé, au-delà d’un simple accroissement budgétaire, en allant vers une réforme structurelle et un modèle de santé plus universel.
Par ailleurs, la pénurie de personnel médical est un enjeu à l’échelle de l’UE et nécessite d’avoir une vision globale pour inciter les carrières, revaloriser les emplois et mieux définir le périmètre des activités de chaque profession (médecin, infirmier, pharmacien…), pour une meilleure gestion des ressources.